
Objectifs d’apprentissage
Dans cette activité d’apprentissage, nous apprenons à :
- développer une meilleure compréhension du rôle des Forces armées canadiennes dans l’histoire canadienne
- explorer l’implication historique du Canada dans les conflits mondiaux
- reconnaître les sacrifices faits par les Forces armées canadiennes et les civils pendant les périodes de guerre
- réfléchir à la signification du mot « service » et à son lien avec ta communauté et propre célébration du jour du Souvenir

Le savais-tu ?
Le jour du Souvenir (le 11 novembre), les Canadiens rendent hommage aux membres des Forces armées canadiennes qui ont servi le Canada et qui continuent de le faire en temps de guerre, de conflit et de paix. Le 8 novembre, on commémore aussi la Journée des anciens combattants autochtones pour souligner les contributions des Canadiens autochtones, passées et présentes, en soutien à notre pays.
On va en apprendre davantage sur l’importance du jour du Souvenir, et sur le service et les sacrifices de nos Forces armées canadiennes pour tous les Canadiens

Réflexion
Réfléchis aux questions suivantes :
- Que font les Forces armées canadiennes et comment soutiennent-elles le pays ?
- Quelle est l’implication historique du Canada dans la guerre et les conflits mondiaux ?
- Quels sacrifices ont fait les Canadiens en temps de guerre ?
- Pourquoi célèbre-t-on le jour du Souvenir ?
- Pourquoi nous souvenons-nous ?
Examine les images suivantes pour découvrir comment les Forces armées canadiennes ont soutenu le Canada par le passé, et comment elles continuent de le faire aujourd’hui.
Maintenant que tu comprends mieux comment les Forces armées canadiennes soutiennent le Canada, on va discuter de l’importance de rendre hommage aux anciens combattants le jour du Souvenir.

Discussion
Pourquoi célèbre-t-on le jour du Souvenir ? Utilise les questions dans la section « Réflexion » pour orienter ta discussion.
Les conseils ci-dessous t’offriront des pistes supplémentaires.
Clique sur le bouton Afficher les astuces pour en savoir plus.
Afficher les astuces
N’hésite pas à participer : les discussions sont des occasions d’apprendre les uns des autres. Plus tu participeras, plus tu apprendras.
Sois inclusif : toutes les opinions sont importantes. Partage tes idées et réagis à celles de tes camarades de manière respectueuse. N’aie pas peur de changer d’avis et d’envisager différentes façons de voir les choses.
Utilise des exemples tirés de l’activité d’apprentissage : selon le sujet de la discussion, il peut être utile de faire des liens entre ce que tu partages et les expériences vécues dans l’activité d’apprentissage. C’est un excellent moyen de renforcer ce que tu as appris.
Réfléchis avant de partager tes réflexions : demande-toi si elles sont utiles et pertinentes par rapport au sujet abordé, et si elles sont appropriées pour tout le monde dans la classe, y compris ton enseignant. Utilise un ton respectueux.
Pendant votre discussion sur le jour du Souvenir, vous avez peut-être exploré comment le service et les sacrifices des Forces armées canadiennes ont aidé à assurer notre sécurité. Prends un moment pour réfléchir à ce que signifient pour toi les mots « sécurité », « service », « sûreté » et « sacrifice ».
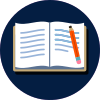
Journal
Prends en note tes réponses aux questions suivantes en utilisant la méthode de ton choix. Tu peux également effectuer l’activité sur ce Journal de réflexion.
Sécurité : Dans quels conflits mondiaux le Canada a-t-il été impliqué ? Nommes-en quelques-uns.
Service : Qu’est-ce qui peut pousser une personne à se joindre aux Forces armées canadiennes ?
Sûreté : Quels sont les défis auxquels les membres des Forces armées canadiennes peuvent être confrontés ?
Sacrifice : Que signifie pour toi le mot « sacrifice » ?

Sécurité
L’histoire du Canada pendant les conflits mondiaux
Dans la section « Activation », tu as eu l’occasion d’observer des images des Forces armées canadiennes et de commencer à réfléchir à la sécurité, au service, à la sureté et aux sacrifices des Forces armées canadiennes. Maintenant, on va explorer l’implication du Canada dans les conflits mondiaux.

À toi maintenant !
Complète le jeu-questionnaire d’autoévaluation pour tester tes connaissances sur la participation du Canada dans les conflits mondiaux.
Lis les questions suivantes et sélectionne la bonne réponse. Ensuite, clique sur « Vérifier la réponse » pour connaître la bonne réponse.
Le jeu-questionnaire de la section « À toi maintenant ! » nous a permis d’en apprendre davantage sur l’implication du Canada dans les conflits mondiaux.
Appuie sur les onglets ci-dessous pour en savoir plus sur la participation du Canada dans les différents conflits mondiaux à travers les années.
En 1914, la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l’Allemagne. Comme le Canada faisait encore partie de l’Empire britannique, il a automatiquement été impliqué dans le conflit. Plusieurs personnes ont choisi de s’enrôlerSe porter volontaire pour devenir membre des forces armées canadiennes., car elles croyaient qu’aider la Grande-Bretagne à remporter la guerre était la bonne chose à faire.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a déclaré la guerre à l’Allemagne nazie de manière autonome. Le Canada voyait le fascismeUn système politique où le gouvernement détient un contrôle total. Les gouvernements fascistes encouragent souvent le nationalisme et le racisme. comme une menace mondiale, et plusieurs Canadiens se sont enrôlés pour empêcher les politiques d’Hitler de se répandre dans le monde entier.

En 1945, plusieurs pays se sont réunis pour créer les Nations UniesUne organisation internationale visant à encourager la coopération entre ses 193 États Membres, à réduire et à réguler les tensions internationales et à promouvoir les droits de la personne. afin d’aider à prévenir d’autres conflits internationaux. Lorsque les soldats nord-coréens ont envahi la Corée du Sud, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé d’envoyer des troupes pour tenter de rétablir la paix et la sécurité dans le monde. En tant que membre des Nations-Unies, le Canada a déployé des troupes en 1950 pour soutenir les efforts de combat et de maintien de la paix.

En 1949, le Canada s’est joint à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Les pays membres de l’OTAN s’engagent à s’entraider si l’un d’entre eux est attaqué. En 2003, le Canada est entré en guerre en Afghanistan dans le cadre de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) de l’OTAN, en réponse aux attaques terroristes du 11 septembre aux États-Unis.


Le savais-tu ?
Ce n’est que durant la Première Guerre mondiale que fut créée une unité francophone dans l’armée canadienne. À l’époque, il n’existait aucun bataillon permanent pour les soldats francophones. Au début de la guerre, une délégation du Québec se rendit ainsi à Ottawa pour demander la création d’une telle unité. Peu de temps après, le 21 octobre 1914, le Royal 22e Régiment fut créé.
Pour en apprendre davantage sur la participation des Canadiens-français durant la Première Guerre mondiale, consultez notre exposition Mobiliser un pays : le Canada et la Première Guerre mondiale !

En savoir plus
En cliquant sur le lien externe suivant, tu pourras en savoir plus sur les Forces armées canadiennes au fil des ans.
Service
Raisons de s’enrôler
Jusqu’ici, nous avons exploré une partie de l’implication du Canada dans les conflits mondiaux. On va maintenant réfléchir aux raisons pour lesquelles les Canadiens pourraient choisir de s’enrôler dans les Forces armées canadiennes.

Discussion
De nombreux Canadiens choisissent de rejoindre les Forces armées canadiennes pour servir leur pays. Discute d’autres raisons qui pourraient les amener à s’enrôler.
Après la discussion, clique sur « Raisons de s’enrôler » pour en savoir plus.
Raisons de s’enrôler
Les Canadiens peuvent chercher à :
- voir de nouveaux endroits
- servir leur pays
- suivre les traces de membres de leur famille
- faire une différence dans leur communauté
L’enrôlement dans les Forces armées canadiennes est fait sur une base volontaire. Même si la conscriptionLorsqu’un gouvernement adopte une loi qui oblige les gens à s’enrôler pour le service miliaire. a été imposée pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des enrôlements étaient volontaires. Les raisons qui amènent les gens à s’enrôler sont nombreuses, mais cela revient souvent à un désir d’aider les autres.
Explore le récit suivant pour en savoir plus sur les raisons qui peuvent motiver quelqu’un à s’enrôler.
Portrait d’un soldat : Seizaburo Kimura
Seizaburo Kimura faisait ses études à l’Université de Toronto quand la Première Guerre mondiale a commencé. Il a choisi de s’enrôler dans le corps médical parce qu’il estimait que c’était l’endroit où il pourrait aider le plus de personnes. De novembre 1915 à mai 1917, il a travaillé à l’Hôpital général canadien no 4, à Salonika, en Grèce. Durant cette période, il offrait du soutien aux militaires blessés ou mourants au moment où ils en avaient le plus besoin.


Le savais-tu ?
Le gouvernement espérait initialement recruter 25 000 personnes, mais dès le premier mois de la Première Guerre mondiale, 33 000 Canadiens se sont portés volontaires pour servir leur pays.
En total, 650 000 Canadiens et Terre-neuviens, dont 15 000 Canadiens-français, se sont enrôlés durant la guerre.
Soutien sur le front intérieur
Même si tout le monde n’a pas l’envie ou la possibilité de servir dans les forces armées, cela n’a jamais empêché les Canadiens d’apporter leur aide pendant les conflits mondiaux. Au cours des deux guerres mondiales, les Canadiens sur le front intérieur ont trouvé différentes façons d’appuyer l’effort de guerre.
Appuie sur les onglets ci-dessous pour en savoir plus.
Les collectes de fonds étaient une tâche importante des Canadiens restés au pays. Des groupes de femmes organisaient des bazars où elles vendaient des produits faits maison afin d’amasser des fonds pour les militaires et leurs familles. Les femmes et les enfants tricotaient des bas, des foulards et d’autres vêtements pour les militaires au front. D’autres articles essentiels, comme du savon et des aliments en conserve, étaient envoyés avec les vêtements. Il arrivait même que l’on glisse de petits mots d’encouragement dans les emballages pour garder le moral des militaires outre-mer.

Dès 1914, le gouvernement canadien et les gouvernements provinciaux se sont engagés à fournir des denrées alimentaires pour soutenir l’effort de guerre. Les fermes devaient donc produire plus de nourriture pour répondre à la demande, mais de nombreux agriculteurs quittaient leur emploi pour partir au combat outre-mer. Plusieurs élèves du secondaire, encore trop jeunes pour quitter le pays, ont répondu à l’appel en rejoignant le programme des « soldats de la terre ». Ce programme national envoyait des élèves des villes pour travailler dans les fermes à travers le pays. En Ontario, plusieurs femmes ont rejoint le Corps du service agricole. Ces fermières (que l’on appelait « farmerettes ») s’occupaient d’une panoplie de tâches sur les fermes, de la cueillette des légumes à la mise en conserve des fruits. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle génération de « farmerettes » offrait une aide similaire dans des fermes ontariennes et québécoises.

Plus les hommes se joignaient au combat outre-mer, plus les entreprises avaient besoin de main-d’œuvre. Les Canadiennes ont alors pris la relève en aidant à la fabrication de nombreux produits nécessaires à l’effort de guerre. À mesure que la production de matériel militaire augmentait, des matériaux comme le métal, le caoutchouc et le papier se faisaient de plus en plus rares. Des gens de partout au pays recueillaient de la ferraille et l’apportaient aux collectes locales où elle était réutilisée pour l’effort de guerre.


Le savais-tu ?
Le coquelicot est un symbole porté pour honorer les sacrifices faits et pour rappeler l’importance de préserver la paix. Même si le symbole provient d’un poème canadien, nombreux sont les pays qui l’utilisent.


Sûreté
Les dangers sur la ligne de front

La vie au front
Servir son pays implique parfois de faire des sacrifices, y compris de renoncer à son propre confort pour se rendre dans des zones dangereuses de conflit. Durant la Première Guerre mondiale, l’endroit le plus risqué pour les militaires était les tranchéesLongs fossés étroits où se déroulait la majorité des combats.. Les tranchées ennemies se trouvaient à proximité, après une zone connue sous le nom de « no man’s land ». Les conditions de vie dans les tranchées étaient très pénibles. Comme il n’y avait pas de vrais lits dans les tranchées, les soldats devaient dormir dans des abris ou à même le sol. Les déchets des latrinesUne toilette de tranchée, généralement un fossé pouvant être utilisé par plusieurs personnes en même temps. avoisinantes s’accumulaient, ce qui signifie que les conditions d’hygiène des tranchées étaient très mauvaises. Les soldats étaient entourés de rats, de poux, de larves et de mouches qui transmettaient des maladies et posaient d’autres risques pour leur santé. En plus, les tranchées n’étaient pas à l’abri des intempéries. En hiver, l’exposition au froid et à la neige entraînait des engelures. Aussitôt qu’il pleuvait, les tranchées se remplissaient d’eau. Par conséquent, plusieurs personnes souffraient de pied de tranchéeUne maladie douloureuse causée par une exposition prolongée des pieds au froid et à l’humidité. Les cas les plus sévères nécessitaient souvent une amputation..
Vous n’avez aucune idée des conditions dans lesquelles on se trouvait. Tu es sale, couvert de boue, en piteux état, tu sens mauvais, et c’est comme ça. Tout le monde sent mauvais, donc tu ne remarques même plus l’odeur.
– Roy Henley, 42e Battalion
Pertes causées par la guerre
La guerre est dangereuse. À elle seule, la Première Guerre mondiale a causé plus de 172 000 pertesDans le contexte militaire, une « perte » désigne tout individu qui ne peut plus exercer ses fonctions, y compris ceux qui ont été blessés, tués ou qui sont détenus comme prisonniers de guerre. canadiennes. Les risques de la ligne de front sont nombreux.
Appuie sur les onglets ci-dessous pour explorer des récits sur certains des dangers associés au service militaire.
Ethelbert « Curley » Christian est né aux États-Unis au début des années 1880. Il s’est enrôlé dans les forces armées le 22 mars 1915 à Selkirk, au Manitoba. Alors qu’il transportait des provisions jusqu’aux lignes de front, il a été gravement blessé par un explosif. Christian est devenu le premier membre des Forces armées canadiennes à survivre à une amputation quadruple pendant la Première Guerre mondiale. Une fois la guerre terminée, il a déménagé à Toronto et a participé à la création d’un programme d’assistance sociale pour les vétérans blessés. Il a aussi collaboré étroitement avec des organismes communautaires, y compris l’organisme l’Association des Amputés de guerre, pour venir en aide à d’autres personnes amputées.

Kenneth Allen Gray est né à Port Arthur en Ontario, en 1931. En 1951, il s’est enrôlé dans le Lord Strathcona’s Horse et a été déployé en Corée. Pendant son séjour, il a contracté une fièvre hémorragique, une maladie peu connue du personnel militaire canadien. Au début, Gray et les membres de son escadron croyaient qu’il avait la grippe, mais comme son état empirait, ils ont décidé de l’envoyer au 8228e hôpital militaire de campagne. Malheureusement, Gray a perdu la vie le 14 juin 1952. Il a été enterré au Cimetière commémoratif des Nations Unies à Busan et commémoré sur le Mur du Souvenir de la guerre de Corée, à Brampton, en Ontario.

Le caporal retraité Chris Dupee a servi dans les Forces armées canadiennes pendant près de 10 ans. En 2008, il a été affecté en Afghanistan pour une période de 8 mois pendant la guerre. De retour à la maison, il commença à ressentir les effets du trouble de stress post-traumatique (TSPT).Une condition qui touche les individus qui ont vécu des expériences traumatisantes ou qui en ont été témoins. Les symptômes courants incluent les troubles du sommeil, l’agitation, l’anxiété et la dépression.
« Je ne savais pas ce qu’était le trouble de stress post-traumatique d’un point de vue personnel. Je savais seulement que c’était “quelque chose” que certains soldats avaient. Il est difficile de s’y identifier. Tout ce qu’on peut reconnaître, ce sont ses effets. Alors que ma vie et mes rêves s’effondraient, j’ai commencé à me battre, mais cette fois, dans une bataille invisible. C’est un peu comme frapper dans le noir en essayant d’atteindre un ennemi invisible. Et j’ai seulement compris que je souffrais de ce trouble quand quelqu’un a allumé les lumières et qu’il m’a convaincu de ralentir. Le trouble de stress post-traumatique est une bête invisible avec laquelle je me suis longtemps battu, mais que je réussis maintenant à maîtriser en grande partie. Et même lorsqu’elle montre les dents, sa morsure est maintenant toute petite. Tout cela a été possible grâce à beaucoup d’efforts et d’introspection. » – Chris Dupee, caporal retraité
Pendant son propre parcours de santé mentale, Dupee a compris l’importance du soutien de ses pairs. En 2017, son épouse et lui ont fondé Cadence Health and Wellness Inc., une organisation offrant des services de soutien en santé mentale pour les militaires et les premiers répondants. Aujourd’hui, Dupee continue de sensibiliser les gens aux enjeux de santé mentale liés au service militaire.
Ce sont mes rêves et ma vision que j’ai réintégrés dans ma vie. Et ce sont mes rêves et ma vision qui me permettent de continuer d’aller de l’avant tous les jours.
– Chris Dupee, caporal retraité

William Foster Lickers est un soldat mohawk né à Brantford, en Ontario. Durant la Deuxième Bataille de YpresUne bataille importante de la Première Guerre mondiale qui a eu lieu en Belgique, en 1915. C’est aussi lors de cette bataille qu’a eu lieu la première utilisation de gaz toxiques mortels à grande échelle par les forces allemandes., il est devenu prisonnier de guerre et a été envoyé au camp Goettingen, en Allemagne. Au camp des prisonniers de guerre, il a subi des traitements terribles et a été forcé à travailler dans une mine de sel. Après la guerre, il a continué à souffrir de douleurs musculaires et avait de la difficulté à marcher.

Nous avons exploré certains des nombreux risques et enjeux auxquels sont confrontés les membres des Forces armées canadiennes en période de conflit. Apprenons-en davantage sur les sacrifices faits par les anciens combattants.

Le savais-tu ?
Le nombre de morts dans un conflit cache souvent un nombre bien plus élevé de blessures non mortelles, qui peuvent tout de même affecter les blessés pour le reste de leur vie. Plus de 2 000 membres des forces armées ont subi des blessures lors de la plus récente guerre du Canada en Afghanistan.
Portrait d’un soldat : Jean-Napoléon Maurice
Originaire de Montréal, Jean-Napoléon Maurice était avec les Fusiliers Mont-Royal lorsqu’il participa au terrible raid de Dieppe, le 19 août 1942. Ce jour-là, les Alliés échouèrent à défaire les défenses allemandes sur les plages de Dieppe et sont à la merci de leurs mitrailleuses durant de longues heures. Avec courage, Maurice réussit à sauver la vie de quatre soldats blessés avant de regagner lui-même un bateau pour revenir en sécurité. Maurice fut ensuite transféré avec le Royal 22e Régiment, où il combattit avec eux en Italie, jusqu’à être blessé lui-même en 1944.
Un homme de peu de mots, Maurice parla très peu de ses expériences durant la guerre. Au Canada, il devient porteur dans des trains, aidant, du même coup, plusieurs soldats blessés de retour au pays. Il déménagea éventuellement à Magog, en Estrie, où il devint une personnalité connue de la région.

Sacrifice
Le coût de la guerre
Ce ne sont pas tous ceux qui vont à la guerre qui ont le privilège d’en revenir. De nombreux Canadiens ont fait le plus grand sacrifice qui soit dans le cadre de leur service.
La guerre en chiffres
Explore le tableau interactif ci-dessous pour en apprendre davantage.
Nombre de membres des Forces armées canadiennes décédés
Clique sur chaque section de l’image pour explorer le contenu.

Le savais-tu ?
Le 20e siècle est parfois appelé « le siècle le plus sanglant de l’histoire ». À elles seules, il est estimé que les deux guerres mondiales avaient coûté la vie à 60 millions de personnes partout dans le monde.
Les conséquences de guerre sur les familles
La guerre n’affecte pas seulement les membres des forces armées, elle affecte aussi toutes les familles qui sont laissées derrière.
En voici quelques exemples :

Gérard Doré avait 15 ans lorsqu’il quitta sa famille à Val-Jalbert pour entrer, à leur insu, dans l’armée. Mentant sur son âge, Gérard réussit à s’enrôler en 1943 et est envoyé peu de temps après en Europe. Avec les Fusiliers Mont-Royal, le jeune Doré participe directement aux combats en France : déployé le 8 juillet 1944 en Normandie puis se rendant jusque dans le Calvados. Le 23 juillet, lors de la bataille de la Crête de Verrières, Doré est mortellement touché et décède le lendemain. La nouvelle de son décès choqua grandement sa famille qui tenta, en vain, de le ramener au Québec en plaidant son âge. À son décès, Doré n’était qu’à un mois de son 17e anniversaire et devint, par le fait même, le soldat allié le plus jeune sur le front de l’ouest.

George et Joseph Hong étaient des frères de Windsor, en Ontario. Avant la Deuxième Guerre mondiale, Joseph travaillait dans l’équipe marketing du journal Windsor Star. George, qui était deux ans plus jeune, travaillait au restaurant de ses parents, le Sunnyside Café. Joseph s’est enrôlé dans l’Aviation royale canadienne, alors que George s’est enrôlé dans l’armée. Malheureusement, aucun des frères n’a survécu à la Guerre. Le 23 mai 1944, l’avion de Joseph a disparu. La famille Hong espérait toujours qu’il soit en vie, mais au mois d’août 1945, les autorités ont confirmé le décès de leur fils. Peu de temps après que Joseph ait disparu, la famille Hong a appris que George avait été tué en Italie. En l’espace de quatre mois, les parents de George et Joseph ont perdu deux de leurs enfants. Comme les deux frères ont perdu la vie à l’étranger, leur famille n’a pas pu visiter leurs tombes. Leur mère a fait parvenir une lettre pour tenter d’organiser l’envoi de fleurs sur la tombe de George, mais cela n’a pas été possible.

Émilien Dufresne avait très peu conception de la guerre, lorsqu’il se porta volontaire dans l’armée canadienne en 1941. Le jeune gaspésien est alors incorporé dans le Régiment de la Chaudière, où il passe plusieurs mois en garnison en Grande-Bretagne. Le 6 juin 1944, durant le débarquement de Normandie, le soldat Dufresne est parmi les premiers à arriver sur les plages. Malheureusement, le lendemain, il est capturé par une patrouille allemande et est fait prisonnier de guerre. Il passe ainsi 10 mois en captivité. Durant cette période, Dufresne peine à communiquer avec sa famille. Si les prisonniers de guerre pouvaient rédiger des lettres, celles-ci étaient minutieusement étudiées et, au besoin, censurées par les gardes allemands. À l’angoisse des conditions de vie dans les camps, s’ajoute ainsi celle de ne pas communiquer avec sa famille… jusqu’à sa libération en 1945.

John Arthur Alexander est né en 1918 dans la réserve des Six Nations. En 1942, il a epousé sa femme, Jean. À peine huit mois plus tard, il est parti au combat à l’étranger. Le 6 juin 1944, John et ses compagnons d’armes du Queen’s Own Rifles of Canada ont pris d’assaut la plage Juno Beach lors du débarquement de Normandie. Seulement le tiers des 33 hommes de son peloton a survécu. À la maison, Jean attendait toujours des nouvelles de son mari. Elle a appris pour le débarquement grâce aux films d’actualités au cinéma et dans les journaux. Ce n’est que bien après la fin de l’invasion qu’elle a découvert le rôle joué par son mari. En se rappelant ces moments, Jean raconte « Ce n’était pas comme aujourd’hui où l’on sait tout ce qui se passe en temps réel… je ne savais jamais quand je reverrais mon mari, ni même si j’allais le revoir un jour. » Lors de son service, John a été blessé à plusieurs reprises. En septembre 1944, Jean a reçu un télégramme l’informant que son mari était blessé, mais sans plus d’explications. Ce n’est qu’après la guerre qu’elle a finalement découvert la cause de ses blessures.

Discussion
Nous avons exploré les vraies histoires d’anciens combattants des Forces armées canadiennes. Peux-tu nommer des exemples précis de sacrifices qu’on retrouve dans les histoires de cette activité d’apprentissage ? Selon toi, pourquoi ces personnes ont-elles risqué ou sacrifié leur vie ?
Note tes réponses à la question précédente en utilisant la méthode de ton choix. Si tu veux, utilise cette carte mentale pour compléter l’activité.

Réflexion
Pourquoi est-il important d’en apprendre davantage sur le service et les sacrifices des membres des Forces armées canadiennes lors du jour du Souvenir ? À la lumière de cette activité d’apprentissage, ta compréhension du mot « sacrifice » a-t-elle changé ?

Jour du Souvenir
Tout au long de l’histoire, les Canadiens ont fait de grands sacrifices au service de leur pays.
Dans cette activité d’apprentissage, tu as exploré :
- les Forces armées canadiennes
- l’histoire du Canada dans les conflits mondiaux
- les sacrifices faits par les Canadiens en temps de guerre
- la définition des mots « service » et « sacrifice »

À toi maintenant !
Utilise tes nouvelles connaissances pour vérifier ta compréhension de l’activité d’apprentissage.
Essaie de répondre aux questions suivantes en sélectionnant la bonne réponse, puis clique sur « Vérifier la réponse » pour voir ton résultat.
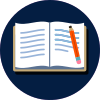
Journal
Maintenant que tu en sais plus sur la participation du Canada dans les conflits mondiaux ainsi que sur le service et les sacrifices des membres des Forces armées canadiennes, prépare une courte réflexion (en utilisant la méthode de ton choix) qui explique pourquoi il est important de souligner le jour du Souvenir, selon toi.


Réflexion
Réfléchis à ce que tu as appris lors de cette activité. Laquelle des phrases suivantes décrit le mieux comment tu te sens par rapport à tes apprentissages ?

Découvres-en davantage
À l’aide des liens ci-dessous, choisis un membre des Forces armées canadiennes sur lequel faire une recherche, incluant la bataille dans laquelle il ou elle a servi. Pense aux sacrifices faits par cette personne, et aux sacrifices faits par les proches qu’elle a dû laisser derrière. Tu peux décider de faire une infographie pour illustrer ton travail, ou d’organiser une exposition dans la classe pour voir et exposer le travail de chaque élève.
Recherche dans les Livres du Souvenir
Recherche – Les Livres du Souvenir – Mémoriaux – Commémoration – Anciens Combattants Canada (veterans.gc.ca)
Dossiers du personnel – Première Guerre mondiale
Base de données des dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale (bac-lac.gc.ca)
Dossier de service des victimes de guerre – Deuxième Guerre mondiale
Deuxième guerre mondiale – Dossiers de service des victimes de guerre, 1939 à 1947 (bac-lac.gc.ca)

Sources liées cours
Certaines images ont été fournies par Getty Images. Les autres images, graphiques, diagrammes et illustrations de ce cours, sauf indication contraire, ont été créés par TVO.

Bannière de la section « Activation » : Le caporal D. Thomson, qui a sonné la Dernière sonnerie au cimetière où sont enterrés les soldats canadiens tués lors du jour J et de la première semaine de l’invasion de l’Europe, Donald I. Grant, Canada. Ministère de la Défense nationale, Bibliothèque et Archives Canada, URL.

Infirmières militaires canadiennes travaillant dans les ruines du 1er hôpital général canadien, qui a été bombardé par les Allemands. Trois infirmières ont été tuées. Ministère de la Défense nationale, Bibliothèque et Archives Canada, PA-003747, URL.

Des brancardiers déchargent un soldat blessé à l’hôpital de la base canadienne d’Abu Sueir, en Égypte (vers 1943-1948). Ministère de la Défense nationale, Bibliothèque et Archives Canada, eCopy, URL.

Le soldat W. Sutherland (à gauche) du Westminster Regiment (Motor) et le soldat V. A. Keddy du Cape Breton Highlanders remballant des rations dans un dépôt de ravitaillement, Cassino, Italie, 18 avril 1944. Lieutenant Strathy E. E. Smith, Ministère de la Défense nationale, Bibliothèque et Archives Canada, PA-151177, URL.

Des soldats servant des repas à des personnes touchées par la tempête de verglas de 1998 dans l’est du Canada, Ministère de la Défense nationale, Bibliothèque et Archives Canada, e999901603-u, URL.

Des soldats canadiens fouillent une route, Musée du Royal Montreal Regiment, 2018.09.115, URL. Reproduit avec autorisation.

Membres des Queens Own Rifles pratiquant le rappel, Musée du Queens Own Rifles, URL. Reproduit avec autorisation.

Le caporal (Cpl) Pellow et d’autres soldats transportant des sacs de sable, mai 2019, Caporal-chef (Cplc) Laurent Ene, Royal Montreal Regiment, publié en 2019 et consulté le 6 août 2024. Reproduit avec autorisation.

Un membre des Forces armées canadiennes enseigne à des enfants un véhicule qu’ils utilisent pendant un événement communautaire, Queen’s Own Rifles of Canada Regimental Museum, URL, publié s. d. et consulté le 6 août 2024. Reproduit avec autorisation.

Exercise Neptune Strike, Musée du Queens Own Rifles, URL, publié le 4 janvier 2011 et consulté le 2 juillet 2024. Reproduit avec autorisation.

Infirmières militaires de l’hôpital général canadien no 10, R.C.A.M.C., débarquant à Arromanches, France, le 23 juillet 1944, Harold G. Aikman, Ministère de la Défense nationale, Bibliothèque et Archives Canada, PA-108172, URL.

Canadiens-Français, Enrôlez-Vous !, 19750046-009, Musée Canadien de la Guerre, URL, accédé le 25 juillet 2025.

« Shoulder to shoulder », Service féminin de l’armée canadienne, Bibliothèque et Archives Canada, Acc. No. 1992-622-3, URL, publié en 1944 et consulté le 2 juillet 2024.

Le drapeau des Nations Unies flotte au-dessus de la rivière Imjin, Corée. Ministère de la Défense nationale, Bibliothèque et Archives Canada, eCopy, URL, publié ca. 1943-1965 and consult le 2 juillet 2024.

Patrouille canadienne en Afghanistan, Musée du Royal Montreal Regiment, 2019.11.54, URL. Accédé le 25 juillet 2025.

Seizaburo Kimura (Victoria College Choral and Glee Club Executives, 1921-1922), Victoria University Archives (Toronto), Photograph Collection, 2003.132 P2, URL et consulté le 2 juillet 2024.

Les femmes tricotent pour les forces armées, fonds de la famille William James, Archives de la ville de Toronto, Fonds 1244, Item 873, URL, publié en 1914 et consulté le 2 juillet 2024.

Farmerettes, fonds de la famille William James, Archives de la ville de Toronto, Fonds 1244, Item 640, URL, publié ca. 1917-1918 et consulté le 2 juillet 2024.

Cecilia Butler, ancienne chanteuse et danseuse de boîte de nuit, maintenant employée comme aléseuse dans la section Small Arms Ltd. de l’usine de munitions John Inglis Company, Office national du film du Canada, Photothèque, Bibliothèque et Archives Canada, e000761869, URL, publié Décembre 1943 et consulté le 2 juillet 2024.

Coquelicot de perles autochtone par l’artiste Kathy Morgan, consulté le 2 juillet 2024. Reproduit avec autorisation.

Une tranchée sur le front canadien montrant des « funk holes », W. I. Castle, Ministère de la Défense nationale, Bibliothèque et Archives Canada, PA-001326, URL, publié en 1917 et consulté le 2 juillet 2024.

Curley Christian, 1421 Lansdowne Avenue, 100% amp case, portrait, Globe and Mail Fonds, City of Toronto Archives, Fonds 1266, Item 40538, URL, publié le 24 juin 1936 et consulté le 2 juillet 2024.

K. A. Gray, Honouring Bravery, consulté le 2 juillet 2024. Reproduit avec autorisation.

Photo de Chris Dupee, via Facebook, consulté le 2 juillet 2024. Reproduit avec autorisation.

William Foster Lickers, The 15th Battalion CEF Memorial Project, URL et consulté 2 juillet 2024. Reproduit avec autorisation.

Jean-Napoléon Maurice, Bibliothèque et Archives Canada, e011871941, URL et accédé le 25 juillet 2025.

Soldat Gérard Doré, Mémorial virtuel de guerre du Canada, URL et accédé le 25 juillet 2025.

Joseph Hong, Deuxième guerre mondiale – Dossiers de service des victimes de guerre, 1939 à 1947, Bibliothèque et Archives Canada, RG 24 Volume 27759, Item 16292, URL et consulté le 2 juillet 2024.

Émilien Dufresne, Historica Canada, URL, publié le 19 octobre 2023 et accédé le 22 juillet 2025. Avec la permission de Historica Canada.

John Arthur Alexander, Black Canadian Veterans Stories, URL. Reproduit avec autorisation.

